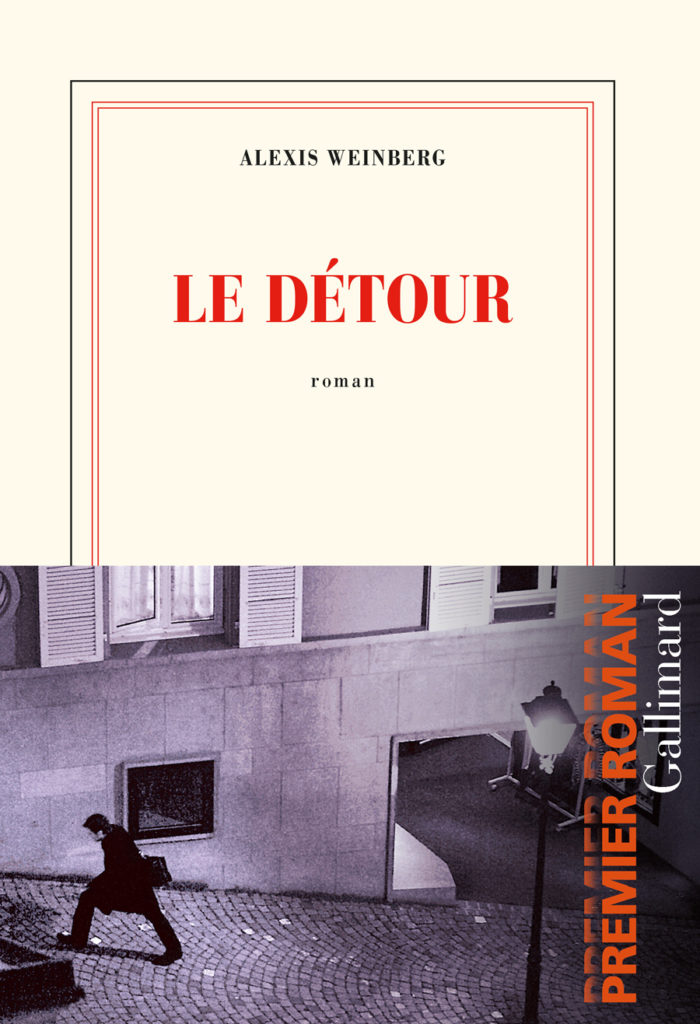
Le Détour, premier roman d’Alexis Weinberg, renferme l’enchantement des premières amours revisitées par un regard acide bien résolu à faire la guerre à la candeur et aux émois, c’est-à-dire, à tout ce que l’on fut.
Au sein d’une lettre qu’on croit d’adieu à la femme qu’il aime, le narrateur révèle les deux faces de l’homme qu’il tente d’être et d’inventer sous nos yeux. L’une procède de l’enfance, de ses illusions et de sa fierté, l’autre est plus tourmentée mais, de ce fait aussi, plus active et déterminée à vivre grâce à l’écriture que des conflits intérieurs produisent avec sagacité.
Son personnage principal est digne de la plume de Franz Kafka ou de Fernando Pessoa. La banalité de sa profession – on croit comprendre qu’il est assureur – contraste avec la profondeur de sa quête intérieure. Héros à rebours, il décrit le monde avec un regard méticuleux et presque las, d’une lucidité implacable. Pourtant, dans chaque portrait de potentiels clients, dans la description navrante des intérieurs inspectés, se glisse l’idée d’une humanité débordant sous des choses et des lieux qui n’ont d’impersonnel que l’apparence. Au fil de ses visites, souvent stériles et poussives, le narrateur s’interroge sans cesse sur « cette stupide énigme d’exister » . On pourrait le croire essentiellement métaphysicien, voire phénoménologue, mais c’est sans compter sur ses dons de satiriste éprouvés. Évoquant une jeunesse peu intrépide et des adversaires qu’il affirme fascinants, il recourt à davantage d’autodérision au début de son récit que dans la deuxième partie du roman, où la phrase se fait plus tendue, le discours plus sincère et plus tendre. À mesure qu’il arpente la ville et ordonne ses souvenirs, il se déleste d’aphorismes métaphysiques d’une pénétration clairvoyante et d’une teneur universelle : « Claire, pourquoi m’en cacher, nous étions tous tombés en amour d’elle, tous. […] C’est qu’à quinze ans, il faut appartenir. Se départir devient ensuite une tâche urgente. Comme il est dur de retrouver, à même la gravité neuve du désir, le sérieux de l’enfance… Il doit être conquis dans les bruits du monde, contre la haine de soi ». L’homme qui se construit sous nos yeux invite à ne plus accabler la vie « sous des devoirs factices, inventés par d’autres pour que l’ordre d’un monde se perpétue » afin de « l’accueillir dans le sérieux bien oublié des premiers étés d’enfance ».
Le Détour est un livre comme on en lit peu aujourd’hui. Sobre de tenue, il fait advenir l’expression juste qu’on cherche tous, fantômes à la recherche d’une passerelle miraculeuse entre notre paysage intérieur riche de désirs contenus, de rêves inaccomplis, et la brutalité d’un monde dénué d’entrain et chiche d’explications.
Entretien avec Alexis Weinberg
Le Détour est votre premier roman. Quand avez-vous commencé à ressentir la nécessité d’écrire ?
J’ai toujours aimé lire, j’ai commencé à écrire à l’adolescence, quand j’ai eu la conviction que la littérature était chose « sérieuse ». La venue à l’écriture a rencontré le « moment adolescent », comme pour d’autres : l’écriture a fait passage. J’ai ensuite eu une sorte de longue période d’apprentissage, où j’ai beaucoup écrit, avant de me décider à rendre public ce que j’écrivais.
Dans votre roman, le personnage principal écrit autant qu’il arpente la ville ; en quoi ces deux activités sont-elles liées pour vous ?
Cette marche dans la ville est portée par une forme d’incertitude : c’est en cela que les deux (marche et écriture) peuvent avoir partie liée. Il y a évidemment toute une littérature de la déambulation dans la ville, d’errance plus ou moins onirique. Pour ma part, je ne peux écrire qu’à partir d’une tache aveugle que l’écriture doit déplacer, sans pouvoir l’abolir. Il m’arrive de prendre quelques notes sur un dictaphone, tout en me promenant, quand l’écriture est bloquée. Mais le mouvement est ici essentiellement intérieur.
Tout en étant adressée à une femme bien réelle et évoquant les difficultés de la vie d’un couple, votre écriture esquive la description sociologique qui triomphe actuellement dans la littérature contemporaine. Pourquoi ce choix ?
C’est une question que je me suis posée. Le narrateur exerce la profession de chargé d’études de marché, il a donc recours à des méthodes de sociologie appliquée ; cet usage de l’enquête est pris dans des intérêts économiques, dans une violence symbolique. La conscience sociale n’est donc pas absente : le contexte de chacun des entretiens qu’il mène dans la journée est bien marqué et différencié. Toutefois, j’ai souhaité me situer au plus près de l’expérience du narrateur, de la « fragilité » de cette expérience, ce qui impliquait de mettre en sourdine les métadiscours. Cela, afin de ne pas écraser le « non-savoir » du narrateur sous un appareil d’analyse trop explicite.
Le Détour s’apparente à un roman d’introspection, un roman qui s’inscrirait dans la grande tradition française du roman d’analyse psychologique. Vous sentez-vous appartenir à cette tradition romanesque ?
Je me suis intéressé, à l’époque de l’écriture du Détour, à des « récits » qui travaillent leur propre voix énonciative, comme s’ils cherchaient à en revenir à la source. Aussi différents soient-ils, je pense à Bataille, Blanchot, Duras, Des Forêts, Henri Thomas et d’autres. Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après « l’ère du soupçon », le Nouveau roman, je me méfie quelque peu d’une analyse psychologique qui se croirait transparente à elle-même. En revanche, un certain roman d’analyse, plus suspensif que conclusif, me va bien. Je crois qu’il reste un outil efficace, un plan projectif intéressant, pour y déployer des personnages qui, au-delà de « l’illusion référentielle », sont des vecteurs de recherche et de questionnement.
Comment vous est venu le titre de votre roman ? S’est-il imposé rapidement à vous ?
Le titre s’est imposé assez vite, oui. Le détour évoque l’« après-coup », le « contretemps », un ensemble de figures qui inquiètent une conception trop linéaire du temps vécu. C’est, je crois, le point qui m’intéresse le plus. Que signifie qu’un événement passé ne soit pas encore véritablement advenu ? Quel « détour » faut-il pour que cet événement se « temporalise » ?
Le roman se développe autour d’une lettre et de sa réponse entre un homme et la femme qu’il aime ; entre les deux, la naissance d’un récit commandé par un rapport essentiellement écrit au monde. L’écriture est-elle pour vous une modalité de dialogue avec la réalité qui vous entoure ? Ou bien le dernier recours quand le dialogue n’est plus possible ?
C’est une belle question ! Les deux branches de l’alternative sont liées. Il me semble n’entrer vraiment en rapport au monde qu’à partir d’un espace encore partiellement obscur, où je sens que quelque chose d’important se joue. L’écriture ouvre cet espace où les questions peuvent être approfondies, où la distance qu’interdit généralement la conversation ordinaire peut faire apparaître les choses, les êtres, les situations sous une lumière inattendue, étrange. C’est en effet depuis ce lieu – lieu de l’adresse à l’autre – que l’écriture peut cheminer, là où le dialogue quotidien n’est plus opérant.
Il serait mal fondé de dire que votre roman parle d’identité, disons plutôt qu’il aborde la question de la connaissance des différents « soi » qui composent un être. L’écriture peut-elle, selon vous, permettre d’accéder sérieusement à une certaine connaissance de soi ?
Il y a en fait une tension ici. L’écriture est au service non pas tout à fait du sujet qui écrit, mais d’une production qui possède sa réalité propre, qu’on peut appeler « texte », « œuvre », etc. À cet égard, l’écriture peut être un moyen de faire fond sur son matériau fantasmatique, en continuant surtout à se méconnaître ! D’où la réticence historique de certains écrivains devant la perspective d’une psychanalyse… Toutefois, il ne fait aucun doute qu’une certaine pratique régulière de l’écriture oblige à se confronter à soi, à frayer des voies, à clarifier certains points – sans aller jusqu’à la belle formule proustienne, à la littérature comme « vie éclaircie ». La pratique « subjective » celui qui écrit selon un pli original. En écrivant, il s’invente. Aussi l’écriture a-t-elle fait de lui quelqu’un d’autre. De plus lucide, peut-être… C’est difficile à dire.
En rapport sans doute avec ce processus de quête de soi et de son désir, il est souvent question d’oubli et d’amnésie dans Le Détour : comment l’expliquez-vous ?
La mémoire est irréductiblement tramée d’oubli. Je suis habité par le sentiment d’une étrangeté à moi-même, souvent subie, dont je devine pourtant qu’elle est une condition même du désir. C’est cela qui me passionne, rendu d’autant plus sensible dans nos sociétés où les étayages symboliques se font plus fragiles, tandis que les matériaux d’archives numériques prolifèrent. Je crois vraiment que l’écriture peut travailler à même cette réalité : qu’elle n’est autre que ce tremblement, cet écart toujours relancé. Peut-être qu’au fond, j’attends, je guette quelque chose… C’est un autre vaste sujet, qui nous conduirait peut-être du côté de la « messianité »…
