
L’entretien lecture
par Fanny Arama
Le Tumulte, de Sélim Nassib, restitue trois périodes clef de l’existence du narrateur, Youssef.
Jeune Juif né à Beyrouth après la guerre, systématiquement renvoyé à Israël dans un pays en ébullition confessionnelle au cœur du Moyen-Orient, il est d’emblée englouti dans un maelström de culpabilité à l’égard des Libanais mais aussi à l’égard des Juifs, pris entre le désir de s’affranchir de sa communauté d’origine et la colère que lui inspirent les divers devoirs de loyauté que la société et sa conscience déchirée lui imposent. En 1956, il est élève de l’Alliance universelle ; en 1968, il prend part à toutes les manifestations étudiantes et à leurs revendications révolutionnaires et égalitaristes ; en 1982, après des études à Paris, il décide de retourner à Beyrouth-Ouest afin de couvrir la guerre avec Israël pour Libération. Dans un pays où tout le monde se replie sur sa communauté, Youssef poursuit, autant qu’il le peut, les trous d’air qui le conduiront à la liberté d’être et de penser. Il a quelque chose du romantisme désespéré d’Edmond Dantès – jeune comte de Monte Cristo de Dumas – enfermé malgré lui par des ennemis invisibles mais omnipotents, et passant le reste de sa vie à corriger cet empêchement amer. Sa personnalité fait du roman un joyau restituant à la fois le génie de l’enfance, le charme puéril du jeune bourgeois révolutionnaire et l’hébétement de l’homme égaré dans et par la guerre, à la recherche d’un lieu où exister.
Le roman flamboie de la grâce d’une écriture épousant tous les soubresauts de son narrateur. On adore l’aplomb intrépide de Youssef traversant les limites interdites de son quartier à douze ans : « Je n’ai jamais pris le tramway seul […] Nous dépassons Bab Edriss. Les devantures défilent, et les passants. Place des Martyrs, rien ne se passe, personne ne me retient. La place est si grande. Le tramway franchit la frontière du dernier territoire connu. J’ai réussi ». On tremble pour lui quand, militant politique en 1968, rêvant d’un Liban où chacun serait libre d’être soi, il est jeté dans une cellule surpeuplée de la prison de la Sûreté et brutalisé par des prisonniers au bord de l’asphyxie. On maudit la guerre et les chantages odieux qu’elle occasionne à ses côtés quand, reporter à Beyrouth-Ouest en 1982, il sombre dans l’héroïne pour tolérer l’intolérable. On est juif avec lui quand il se rappelle qu’un philosophe français a dit que le propre de l’identité juive, c’est « une sorte d’inadéquation entre soi et soi ». Débordant de fusées poétiques et scandé d’interrogations capitales pour l’avenir de toutes les sociétés, Le Tumulte se referme le cœur serré comme tous les livres qu’on ne veut pas finir : avec volupté et recueillement.
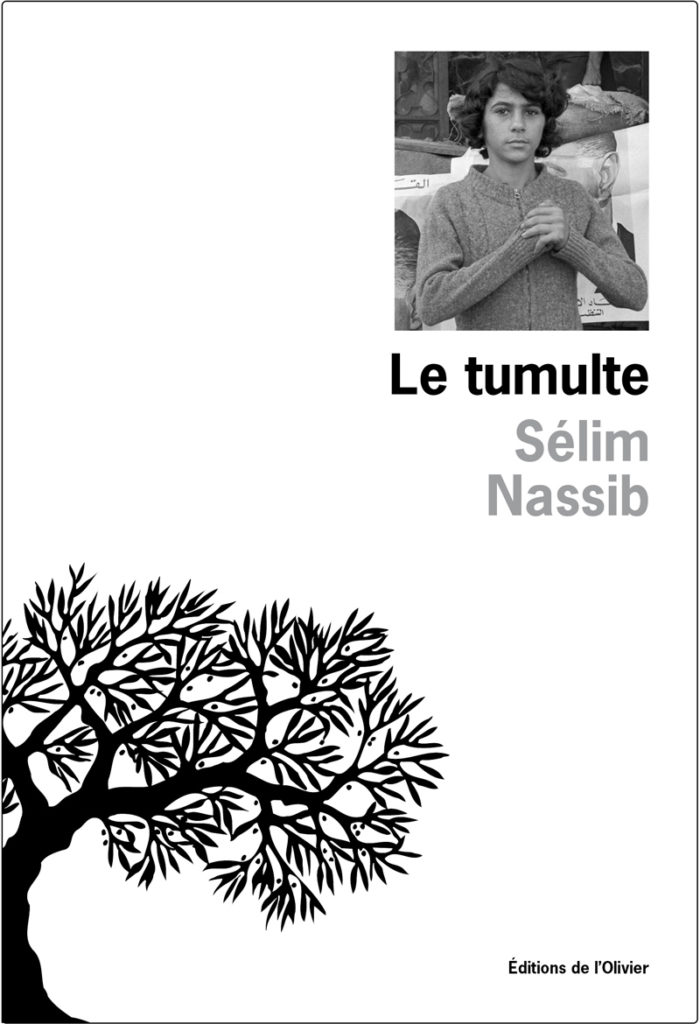
Éditions de l’Olivier, 2022, 21,50 €
Entretien avec SÉlim Nassib
Fanny Arama Comme votre narrateur Youssef, vous avez grandi au Liban et dans les années cinquante et soixante, vous êtes élève de l’Alliance israélite universelle de Beyrouth. Que retenez-vous de cette institution ?
Sélim Nassib C’était une école de très haut niveau. Je l’ai compris bien plus tard, je n’en avais pas conscience alors. J’ai réalisé que l’Alliance était une institution laïque, créée par des Français qui croyaient aux valeurs universelles. Ma mère était fille de professeurs de français à Alep, et la « Fraaance », c’était la chose désirable. Ni le monde Arabe, ni Israël n’étaient désirables. Ma famille appartenait à la petite bourgeoisie et avait la terreur de « tomber plus bas » socio-économiquement. L’amour de la culture française était un plus.
Mais à l’époque, quelque chose m’insupportait à l’Alliance : tout le monde était juif ! Ça me paraissait une chose dégoûtante, presque incestueuse. Le Tumulte est un roman sur le fait de ne pas être enfermé dans sa communauté d’origine, de ne pas être assigné à quelque chose à la naissance. Et mon personnage, Youssef, qu’est-ce qu’il trouve ? Il trouve un non-Juif dans l’école, Fouad, le fils du professeur d’arabe, qui n’est pas d’emblée quelqu’un de séduisant : il est gros, il transpire… Youssef ne s’approche pas de lui par amitié, il s’approche de lui parce qu’il a un autre accent que le sien. L’accent juif dans les années cinquante-soixante au Liban est un peu l’accent syrien ; la mère du personnage vient de Syrie. Pour pouvoir aller ailleurs, il faut changer d’accent. Et ce gros garçon, patapouf, il parle autrement parce qu’il est musulman. Youssef réussit à changer d’accent et, armé de cet accent, il prend le tramway, va dans l’autre quartier, où il rencontre la vraie vie, la vie exaltante, la vie sale, où on baise, où il y a du désir. Alors que dans son quartier d’origine, tout le monde est sage, ce sont des gentils, il n’y a pas de problème, chacun s’enferme dans sa chambre, on va bien mais… on étouffe.
FA : À quelle occasion avez-vous commencé à écrire de la fiction ?
SN : J’étais journaliste et je faisais beaucoup de reportages au Proche-Orient, notamment sur la guerre du Liban. Je parle arabe, donc je comprenais la réalité autrement qu’un journaliste français. J’imaginais mon activité comme une activité de traduction pour un public français. Jusqu’au moment où malgré tout, la politique journalistique est devenue assez superficielle, en dépit de l’effort de traduire en profondeur. Il y avait un autre problème pour moi : c’était trop explicite. On me disait souvent : il faut que ce soit clair, limité (« tu as trois feuillets »). Puis, il y a eu une rencontre : Michel Butel, qui relançait L’autre journal, et qui me dit : « Je suis prêt à te donner deux pages ». J’ai inventé une forme, des contes modernes, à la morale ambivalente, qui se passaient essentiellement dans le monde arabe, mais aussi en Afrique ou ailleurs. Butel était content. Au bout de six ou sept numéros, un éditeur est venu me voir en me demandant : « Pourquoi tu ne publierais pas cela en nouvelles ? ». Ça a commencé comme ça.
FA : Le Tumulte se présente sous la forme d’un triptyque. On suit le narrateur en 1956, alors qu’il est élève de l’Alliance, en 1968, étudiant révolté, et en 1982, à Beyrouth pendant la guerre. Quelle est l’histoire de la rédaction de ce roman ? Avez-vous repris des choses écrites par le passé ?
SN : C’est comme si tout ce que j’avais vécu et tout ce que j’avais écrit a été un bloc qu’il a fallu sculpter. J’ai réussi à entrer dans une matière première, jusqu’à trouver un nerf qui irait de bout en bout. Il y a eu un énorme travail de montage, mais à partir du moment où cette ligne-là a été claire, le monde imaginaire a pu venir s’agréger pour créer un tuyau vivant. Une fois que j’ai commencé à travailler, et à entrer dans le fatras qu’a été ma vie, ça a dû prendre un an. Enfin, ça a pris trente ans ! Dans la troisième partie qui traite de la guerre, j’ai ressorti tous les articles que j’avais écrits à l’époque.
Je peux vous donner un exemple. Quand j’étais à Beyrouth en 1982, j’ai pris un cargo pour quitter la ville, parce que l’aéroport était fermé. Soudain sur le bateau, on réalise que le grand poète palestinien Mahmoud Darwich est là : on le pousse à dire un poème, il dit un poème, mais Youssef entend que Darwich en a marre, il ne veut plus entendre ce poème, il ne veut plus en entendre parler, c’est quoi cette idée saugrenue de lui faire toujours réciter le même poème ? Voilà l’histoire telle qu’elle est racontée dans Le Tumulte. Et voici comment ça s’est passé en réalité : j’ai effectivement embarqué sur un cargo pourri, Darwich était effectivement sur le bateau mais il n’a absolument pas dit un poème ! Beaucoup plus tard, en écrivant un livre sur une fille de Gaza, elle me raconte que quand elle était en Corée du Sud, Darwich est venu faire une conférence, on lui demande de dire un poème qu’il a dit et après elle entend : j’en ai marre de ce poème ! Pourquoi me fait-on toujours dire le même poème ! Tu prends plusieurs épisodes qui n’ont pas lieu au même moment, tu les combines et ça devient un livre.
Jana, dans le livre, est inspirée d’au moins six filles que je connais – ou que je ne connais pas d’ailleurs ! À la fin, tu ne sais plus qui est qui. Pour l’écriture, c’est formidable. Tu es sur un tapis volant !
FA : Le Tumulte est un livre qui parle de l’ardeur qui émane des groupes : groupes d’amis, d’enfance, ou amis plus choisis, militants politiques par exemple. Pouvez-vous nous en dire plus ?
SN: Oui. Dans le roman, la grande histoire d’amitié de Youssef est celle avec Rocco. C’est un personnage qui lui a appris qu’on pouvait être Juif sans être soumis : adolescent, il lui dit qu’il n’y a aucune raison de baisser la tête, de raser les murs de la vile, etc. Mais ce personnage, à la marge, a un côté un peu bandit, un peu voyou, stalinien même ! – si ce mot a encore un sens – qui fait que par exemple, en 82, cet ami qui a été son mentor jadis veut lui dicter sa manière d’écrire. Youssef se révolte et quitte la maison où Rocco est le maître. Ce même phénomène qui a poussé Youssef à partir de chez lui parce que sa famille l’étouffait le pousse, deux parties plus loin, à quitter la maison de Rocco et le groupe d’amis, qui lui dictent à nouveau une manière de penser qui n’est pas la sienne.
FA : À quelle occasion êtes-vous allé pour la première fois en Israël ? Quel était votre état d’esprit ?
SN : En 1977. J’étais envoyé par mon journal, Libération. J’ai été y faire un reportage.
Je voulais absolument prouver que le gouvernement était raciste… Je n’avais pas des yeux pour voir l’ambivalence de cette société. Ce dont je me sentais proche, c’était le Maspen. Très radical, l’extrême gauche. Toute ma vie j’ai été opposant à la politique israélienne, pour deux raisons : la première, je ne supporte pas que tous les Juifs se mettent ensemble, exactement comme à l’école de l’Alliance à Beyrouth, et la deuxième raison, ce sont les Palestiniens. Cette opposition politique m’a caché la beauté du judaïsme. Ce n’est que récemment, il y a environ dix ans, que j’ai commencé à m’intéresse à ce qu’il y avait derrière la façade. J’aime Tel Aviv, qui a créé un microclimat qui donne refuge à la culture, à la musique, à la critique démocratique. C’est formidable, car je ne connais pas d’endroits qui soit plus stimulant au monde. Le problème aujourd’hui, c’est que tous ces gens n’ont pas réussi à se grouper pour créer un poids politique. C’est atomisé. On se retrouve dans une position terrible.
Dans les années 1970, beaucoup de sionistes disaient à des Juifs opposants comme moi : allez en Israël… J’ai commencé à y aller, mais pas en vacances. Pour des projets de films (je prenais le son et je traduisais l’arabe). J’ai découvert ce que c’était. La tension existant chez les Israéliens critiques de leur gouvernement m’a beaucoup déchirée. Ils sont très vivants, en alerte, et ça aiguise l’esprit. La découverte de la pensée juive à cette époque, que je ne connaissais pas auparavant, et la découverte du meilleur côté des Telaviviens, résistants, ouverts, cela a changé mon regard envers ce pays.
FA : Il me semble que vous êtes retourné au moment des printemps arabes à Beyrouth…
Oui. Jusqu’en 1985, ce qui était dominant au Liban était et le socialisme et le nationalisme arabe. Ce dernier disait quand même que, qu’on soit Juif, Chrétien ou Musulman, il y avait une place. Ce mouvement, personnifié par Nasser, a échoué après la Guerre des Six jours qui a abattu l’armée de Nasser. Puis l’islamisme est monté. Il disait : « Nous, les Musulmans ». Dans cette configuration, les gens comme moi n’avait plus aucune place. Je suis parti. Ceux qui pensaient comme moi se sont tus. Quand le soulèvement des printemps arabe a eu lieu, j’ai réalisé que les idées marchent sous terre, parfois pendant quarante ans. Nous ne voulons plus appartenir à une communauté, nous vomissons ces dirigeants qui sont des chefs communautaires. On réalise que l’histoire n’est pas qu’une succession d’événements. Certaines choses sont latentes, et ressurgissent. Qu’est-ce qui va sortir de cela, aujourd’hui ?
FA : Vous sentez-vous en exil à Paris ?
SN : J’ai une vie formidable à Paris. J’écris, je fais ce que j’aime, je suis avec une femme qui fait ce qu’elle aime. Jusqu’à l’écriture de ce livre, le Liban était comme un clou dans le manteau. De toutes mes forces, je ne voulais pas être en exil. Ça empêche. La nostalgie n’est pas quelque chose qui pousse en avant. Mais ce livre a changé les choses, a fait que j’ai comme abattu mes cartes. Pour la première fois, je me suis avancé à visage découvert. Ce qui est une révolution. J’ai l’impression de m’être libéré de pas mal de fantômes.
FA : Qui est le jeune homme sur la photographie en noir et blanc de la couverture ? C’est toi ?
SN : Pas du tout ! C’est une photo qui m’a été proposée par mon éditeur.
Derrière lui il y avait un portrait de Nasser. J’aime le geste qu’il fait, et le fait que son regard ne soit pas affirmatif.
FA : Comme votre narrateur Youssef, Sélim, vous avez un passeport iranien. Qu’est-ce que c’est que cette histoire de passeport iranien ?
SN : Après la création de l’État d’Israël en 1948, la communauté juive au Liban a gonflé de façon extraordinaire : les Juifs syriens sont arrivés en masse. Pour une raison que j’ignore, ils ont perdu leur nationalité syrienne, et le Liban n’a pas voulu leur donner la nationalité libanaise (son octroi aurait modifié l’équilibre confessionnel du pays), donc ils se sont retrouvés apatrides. Soudain, l’ambassade d’Iran leur a délivré un passeport. Trois possibilités. La première, le Shah d’Iran était ami avec Israël, il a donc donné des passeports. La deuxième, l’explication la plus romantique : un employé véreux de l’ambassade a donné les passeports, le Shah s’en est rendu compte et les a annulés, et à ce moment une jolie femme de la communauté juive, Selly Sasson, a pris l’avion pour Saint Moritz, s’est rendue au chalet suisse du Shah et, le lendemain matin, tous les passeports étaient rendus ! Troisième possibilité, la plus plausible, il me semble : le chef de la communauté juive au Liban, qui s’appelait Dichy, était à l’école de Jamhour dans la classe d’un certain Amir Abbas Hoveida, et Hoveida deviendra premier ministre du Shah. Il a convaincu le Shah de conserver ces passeports.
Non seulement j’ai eu un passeport iranien mais, en 1979, lors de la Révolution islamique, il y a eu une réunion pour annuler les passeports des Juifs du Liban et une personne dans la réunion s’est levée pour remarquer : « L’empire d’Iran a toujours été protecteur des minorités ». Qui était-ce ? Un type qui était avec moi à la Cité universitaire à Paris en 1970 et qui, au moment de la Révolution, était en Iran. C’est lui qui a fait que les passeports iraniens des Juifs du Liban délivrés par le Shah ont été renouvelés en 1979, après la Révolution islamique !
FA : En 1982 à Beyrouth, votre narrateur est reporter de guerre pour Libération, et il s’intéresse aux histoires en marge de la guerre. Était-ce votre cas ?
SN : À dire vrai, Libération m’a appelé au bout de quelques semaines, et m’a dit : « Tu ne t’occupes plus de politique ». Pour la politique, on a les dépêches d’agence, Reuters, l’AFP.
J’ai donc commencé à faire autre chose. J’ai trouvé un immeuble avec, à chaque étage, des confessions différentes, et je l’ai complètement transporté dans le livre.
Tout le monde s’intéresse à ce qui est en marge de la guerre. Il y a un gros bombardement et tout le monde a peur. Mais quand il n’y en a plus, ou si peu, tout d’un coup, les petites histoires deviennent l’actualité du héros. On ne peut pas s’intéresser à la guerre tous les jours, enfin, jusqu’au moment où les bombardements redoublent et s’imposent à ton attention. La vie courante, le plaisir, l’érotisme, la culture, deviennent le quotidien. J’imagine que les Ukrainiens vivent la même chose en ce moment. C’est la vitalité de l’être humain qui fait qu’il ne peut pas se concentrer uniquement sur le risque de mort.
