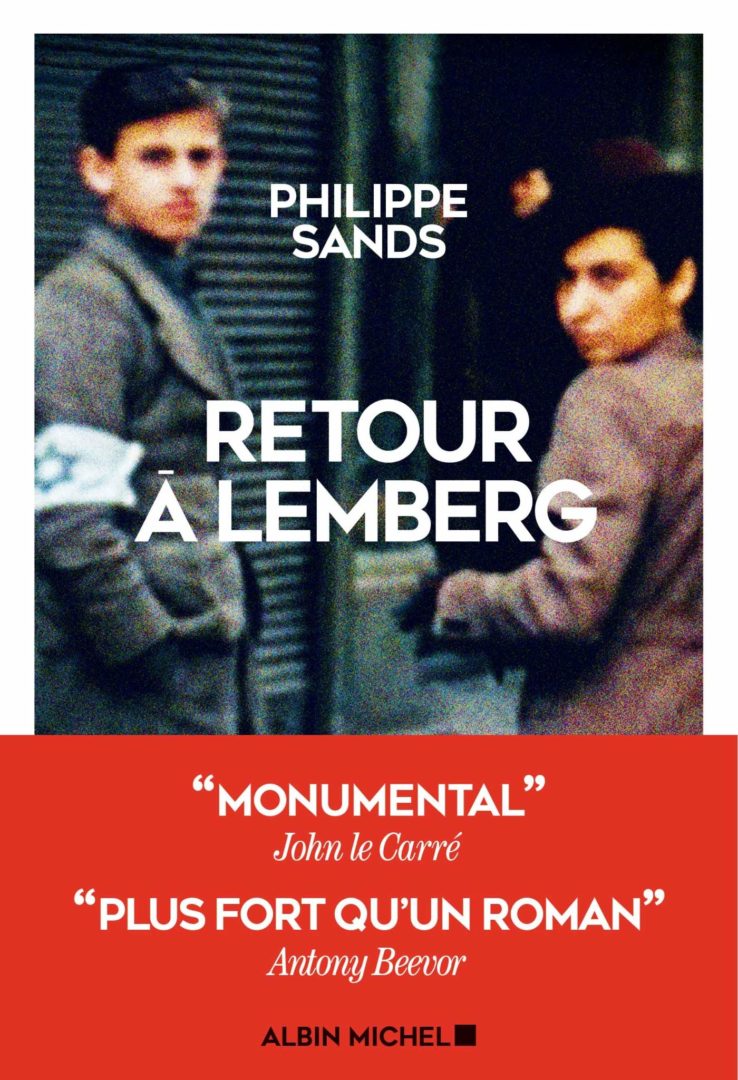Longtemps, on a peu parlé des spoliations matérielles subies par les Juifs vivant en France pendant l’Occupation et le régime de Vichy. Les survivants devaient tenter de reconstruire leur vie et beaucoup n’osaient pas évoquer le pillage de leurs biens alors même que leurs proches avaient été exterminés. Mais au fil des décennies, il est apparu clairement que ce vol organisé avait été une composante de la persécution : privées de toute ressource, les victimes n’en étaient que plus vulnérables.
À la Libération, les autorités de la République française restaurée prennent diverses initiatives pour permettre aux spoliés de faire valoir leurs droits, ouvrant ainsi une première étape dans la politique française de restitution et d’indemnisation.
L’ordonnance du 9 août 1944 frappe de nullité tous les actes « établissant ou appliquant une discrimination fondée sur la qualité de juif ». L’Office des Biens et Intérêts privés (OBIP) recense les biens saisis et renseigne leurs légitimes propriétaires sur les mesures réglementaires nouvellement adoptées. Toutefois, l’importance (numérique et financière), la durée dans le temps et le caractère multiforme des spoliations freinent l’application de la loi qui, en outre, ne concerne que les biens encore placés sous administration provisoire et non pas ceux, fort nombreux, qui ont été vendus ou « liquidés ».
Par ailleurs, les spoliés doivent prendre l’initiative, sans le soutien d’aucune administration centralisée. Or, nombre de déportés sont toujours considérés officiellement comme « absents » et, même si l’on comprend progressivement qu’ils ne reviendront pas, comment déterminer qui est ayant-droit en l’absence d’un acte de décès officiel et alors que beaucoup de papiers ont été perdus ou volés ? De plus, la loi protège de l’expulsion de nombreuses catégories de locataires occupant indûment des logements précédemment habités par des Juifs – sinistrés, épouses de prisonniers de guerre etc. Beaucoup de familles juives ne peuvent réintégrer leur appartement ni récupérer leur atelier ou leur échoppe. Et celles qui y parviennent constatent que leurs meubles, leur matériel, leur stock, ont disparu.
Reste l’éventualité de porter plainte : l’ordonnance du 21 avril 1945 prévoit que les spoliés peuvent déposer une simple requête exonérée de frais, aboutissant à une décision en référé. Mais en réalité, de nombreuses procédures se révèlent complexes, longues et coûteuses.
Il est difficile de dresser un bilan précis des restitutions effectuées au cours de cette première période – d’autant plus que certaines ont été faites « à l’amiable », donc sans laisser de traces écrites – et, plus délicat encore, de déterminer le taux de restitution des différentes catégories de biens spoliés. Mais les recherches montrent que les biens de grande valeur, aisément identifiables et appartenant à des familles mieux armées pour faire valoir leurs droits, ont été plus souvent restitués que les objets d’usage courant ou les machines à coudre.
La loi du 28 octobre 1946 ouvre droit à réparation à tous ceux ayant subi « des dommages certains, matériels et directs, causés aux biens immobiliers ou mobiliers par faits de guerre ». Elle concerne aussi bien les victimes de bombardements, de réquisitions, de pillages divers… que les Juifs spoliés. En outre, il faut avoir eu la citoyenneté française au moment du préjudice pour en bénéficier – ce qui exclut les Juifs immigrés, pourtant les plus nombreux à la veille de la guerre et les plus lourdement touchés. La politique ainsi menée dans cette période de l’immédiat après-guerre est représentative de la conception qui prévaut alors : la spécificité de la persécution des Juifs est méconnue, voire occultée, tue en tout cas, et il ne saurait être question pour eux de faire valoir le moindre droit particulier par rapport à d’autres catégories de Français ayant souffert, « elles aussi ». Il faut fermer la « parenthèse de Vichy » et reconstruire un consensus national profondément fissuré.
C’est le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui initie une nouvelle politique d’indemnisation des « biens juifs » spoliés, en promulguant en juillet 1957 la Bundes-rückerstattungsgesetz dite BRüG, par laquelle il s’engage à dédommager les Juifs allemands pour les pillages subis.
Puis cette disposition est étendue à tout bien dont peut être prouvé le transfert sur le territoire de l’ancien Reich. Plusieurs amendements successifs aboutissent, en 1964, à la BRüG nouvelle sur laquelle peuvent s’appuyer des Juifs spoliés sur le territoire français, avec le soutien du Fonds social juif unifié (FSJU) qui les aide à monter leur dossier. En une dizaine d’années, près de 40000 demandes sont déposées.
Une autre indemnisation, globale, est versée à la France par la RFA, aux termes de l’accord franco-allemand du 15 juillet 1960 : 400 millions de DM sont versés aux autorités françaises, à charge pour elles de les répartir selon ses propres critères. Conformément à la tradition républicaine et à la mémoire de la guerre et de l’Occupation encore dominante, les Juifs ne sont pas, et de loin, les seuls à être pris en compte. Aussi imparfaites soient-elles, ces mesures indemnitaires – dont la RFA espère qu’elles contribueront à lui redonner une place au sein des nations démocratiques – semblent clore le dossier.
ÉVOLUTION MÉMORIELLE
Pourtant, une ère nouvelle s’ouvre dans les années quatre-vingt-dix, dans un double contexte. D’abord, celui des pressions américaines. En 1995, à la demande notamment du Congrès juif mondial (CJM), le président Clinton nomme Stuart Eizenstadt au poste nouvellement créé d’ambassadeur chargé des négociations sur les indemnisations dues aux Juifs d’Europe. À l’origine de cette initiative : la découverte d’une liste de « comptes dormants » en Suisse, tombés en déshérence après la disparition de leurs titulaires juifs assassinés pendant la Shoah. Le risque est réel pour des entreprises et des banques de divers pays d’Europe de se voir traduites devant la justice américaine dans le cadre de class actions, et l’image des pays concernés s’en trouverait sans nul doute ternie. Plusieurs gouvernements mettent en place des commissions d’enquête pour faire eux-mêmes la lumière sur le partage des responsabilités.
On doit aussi et surtout situer la nouvelle politique française en matière d’indemnisation et de « réparation » dans le cadre de l’évolution mémorielle des plus hautes autorités françaises quant aux responsabilités du régime de Vichy dans la politique de collaboration avec l’occupant allemand, et plus spécifiquement dans la persécution antijuive. Si celles-ci ont été clarifiées par les historiens à partir des années 1970, notamment à l’initiative de chercheurs américains – la « révolution paxtonienne » –, il a fallu encore vingt ans d’ambivalences et de tergiversations des présidents de la République successifs avant que Jacques Chirac ne prononce un discours historique lors de la cérémonie commémorative de la rafle du Vél d’Hiv, le 16 juillet 1995 : « […] La France, patrie des Lumières et des droits de l’homme, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. […] Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. »
Avant de « réparer » les dommages commis, au moins sur le plan matériel et financier, il faut d’abord évaluer aussi précisément que possible les spoliations subies par les Juifs de France, ainsi que les restitutions effectuées et les indemnités déjà versées. Telle va être la charge de la Mission d’Étude sur la Spoliation des Juifs de France (dite « Mission Mattéoli », du nom de son président), fondée le 5 février 1997. Les gouvernements successifs, de toutes obédiences, soutiendront cette initiative. Dans ses conclusions, la Mission Mattéoli, déjà saisie de demandes individuelles, suggère la création d’une instance chargée de leur examen. Ce sera la Commission pour l’Indemnisation des Victimes de Spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), fondée par décret le 10 septembre 1999.
Soucieuse de se départir de la « logique de l’assureur » qui a souvent prévalu, la CIVS a retenu le principe d’examiner les requêtes de manière individuelle et personnalisée, en tentant de retracer le destin singulier de chaque famille, de lui restituer son histoire, de contribuer à l’entretien de sa mémoire – à la fois dans la sphère privée et publique – et d’évaluer au plus près possible les spoliations subies. Ce n’est qu’en l’absence de tout document d’archives et de tout témoignage direct qu’elle a recours aux forfaits, contrairement à d’autres pays qui ont opté d’emblée pour ce principe, afin de gagner du temps et de régler plus rapidement les dossiers. Aucun délai n’a été imposé à la CIVS, même si se pose de plus en plus la question d’une éventuelle forclusion au fur et à mesure que le nombre de dossiers tend à diminuer, ni aucune somme maximale.
En décembre 2017, la CIVS avait émis 35 104 recommandations. À la fin de chacune d’entre elles on peut lire qu’« est reconnue au(x) requérant(s) la qualité de victime (ou d’ayant-droit de victime) du fait des législations antisémites ». Au-delà de la légitime indemnisation financière, la signification symbolique de la politique de « réparation » apparaît explicitement.