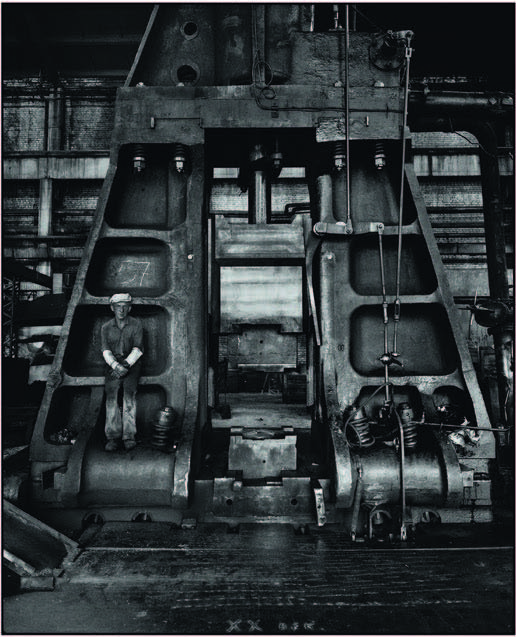On me dira que je commence par la fin. Le voyage serait un aller vers un ailleurs, le retour n’en serait que le moment de l’achèvement. Pourtant, on peut aussi voir les choses autrement. L’an prochain à Jérusalem, dans le berceau du peuple juif. L’aller lui-même serait alors tentative de retour, de retrouvaille avec une origine perdue. Je vais donc commencer par là.
C’est la question que la psychanalyse traite sous le terme de l’objet perdu, dont la perte structurelle, ontologique, est moteur du désir de chacun. On pourrait présenter les choses sous forme de fiction : l’enfant à naître fait un voyage, qui le mène en un lieu nouveau, dont il ne sait rien sinon qu’il est poussé à y aller. Ce lieu nouveau, où il rencontrera autrui et se constituera dans ce lien premier, sera celui de sa naissance comme sujet, mais aussi de ses premières expériences de douleur et de perte. Sa vie entière, l’homme ou la femme qu’il deviendra cherchera à retrouver quelque chose du lieu perdu de son origine. Ce lieu inaccessible, il ne pourra l’imaginer que sous la forme d’un ailleurs. Tout voyage serait alors tentative de retour, par rapport à ce premier aller, ayant éloigné l’enfant du paradis originel. En ce sens, pour Moïse, si l’Égypte qu’il quitte pourrait figurer la mère à laquelle il lui faut s’arracher (selon l’interprétation de Delphine Horvilleur), Israël, qu’il ne peut atteindre, serait aussi une figure de mère, de mère idéale, inatteignable moteur du désir, ce qui expliquerait qu’il lui soit interdit d’y entrer.
Mais si l’on prend en compte l’avancée freudienne sur la répétition, on doit ajouter un autre plan : tout voyage est aussi une répétition du premier voyage de l’enfant à naître, y compris dans ce qu’il a eu de déplaisant. La tentative de tout voyageur serait alors simultanément de retrouver le mouvement d’aller vers le dehors qui a propulsé sa naissance comme sujet. On voit bien alors que la question du voyage est loin d’être linéaire, et que chaque voyage répète à sa manière la quête à la fois de l’origine perdue et du mouvement d’entrée dans la vie, dans une articulation paradoxale entre la recherche de l’objet perdu et la répétition du premier écart avec l’objet.
On pense alors à tout ce que les voyages ont de pénible, de mauvaises surprises, et qui en font aussi l’essence : voyager serait une façon de chercher la rencontre, qu’elle soit bonne ou mauvaise, avec l’altérité. Cette altérité que l’on cherche dans le voyage, c’est celle qui est inscrite en nous-même, ce sont les premières traces de notre constitution comme sujet, dans l’échange avec l’autre qui est à la fois un double, et à la fois irréductiblement étranger.
Le voyage en ce sens peut être une menace pour le psychisme, car il est producteur d’instabilité. Freud, lors d’un voyage à Athènes, a une étrange pensée alors qu’il admire la vue depuis l’Acropole : « Ainsi tout cela existe réellement comme nous l’avons appris à l’école ! ». Il se rend compte qu’il est divisé, clivé par la confrontation à cette vision : une part de lui perçoit qu’il se trouve sur l’Acropole, tandis qu’une autre part continue de ne pas croire, comme dans l’enfance, sinon à l’existence de ce lieu, du moins à la possibilité de s’y rendre un jour.
Cette expérience d’inquiétante étrangeté ou de déréalisation, fait vaciller quelque chose du sujet, l’obligeant à se confronter à ce qu’il a de plus caché (un sentiment de culpabilité vis-à-vis d’un père n’ayant, lui, jamais voyagé). Mais c’est aussi par la grâce de cet instant de perte de soi, que Freud peut faire naître une pensée originale et produire plus tard un texte, « Un trouble de mémoire sur l’Acropole », ouvrant la voie à des avancées théoriques sur la question du clivage.
Ainsi, Freud doit partir : aller à l’Acropole, réellement, pour pouvoir revenir à son fantasme et le voir comme tel : tant qu’il n’avait pas vu l’Acropole il ne pouvait pas connaître son fantasme et donc peut-être pas s’en écarter. Le voyage seul lui permet de se constituer comme sujet à la fois du fantasme et de la réalité, en articulant deux plans auparavant disjoints, et ainsi d’ouvrir à une possibilité subjective nouvelle, celle d’aller un jour à l’Acropole, c’est-à-dire au-delà de là où est allé son père, le conduisant à de nouvelles théorisations.
Quand on passe son temps dans un lieu que l’on connaît par cœur, comme c’est le cas pour la plupart d’entre nous depuis un an, dans le fond on n’a plus besoin de percevoir : le corps sait où sont les choses, tout devient familier, on peut se déplacer à l’aveugle. Finalement on pourrait dire que c’est comme si les objets et le lieu ne se distinguaient plus du corps, comme si on se fondait dans le paysage, dans les murs, le lit, le bureau. Comme s’il n’y avait plus qu’une réalité qui écrase le fantasme.
Mais au-delà du voyage réel, spatial, d’autres expériences peuvent tenir lieu de voyage, et notamment la cure analytique : un voyage dans le passé, dans la recherche du symptôme, c’est-à-dire de ce qui en soi est le plus étranger. Dans la confrontation à cet autre qu’est l’analyste, qui est à la fois un double et un autre radical, quelque chose de l’étrangeté du sujet peut se dire ; quelque chose de l’altérité peut apparaître.
B. dit en séance que sa première thérapie l’a conduite à quitter la ville de ses parents : il lui fallait partir, fuir leur violence. Mais la violence de l’enfance l’a suivie dans son corps, dans ses symptômes somatiques. Après ce premier voyage, voyage nécessaire, réel, elle entame le voyage de la cure ; celui par lequel elle peut se retourner sur la petite fille qu’elle était et la regarder, voyant qu’elle n’est plus tout à fait cette enfant.
Le rêve, par les images qu’il figure, peut-être le lieu privilégié d’un tel voyage. M. rêve d’un village où elle vient de s’installer pour vivre. Le lieu lui apparaît d’abord comme effrayant. Tout est en ruines. Puis elle en fait le tour, elle y accède par l’autre côté. Là, tout est beau, comme dans la réalité. On pourrait dire que l’analyse lui permet de faire le tour du village, de percevoir autre chose que son fantasme d’un lieu effrayant qui se délite. L’analyse lui ouvre l’accès à ce voyage, à ce déplacement qui s’acte dans le rêve : elle n’annule pas la première vision mais y adjoint une autre, l’autorisant à faire le tour de ce lieu terrifiant pour l’explorer par l’autre bord. Voyager serait une façon de changer de perspective, de voir autrement ce qui était toujours là, de s’éloigner pour mieux revenir. Ce serait une façon de lier ensemble deux visions opposées, celle du dedans et celle du dehors, dans un mouvement de déplacement entre les deux.
T. évoque un rêve récurrent de son enfance, dans lequel il volait. Il dit qu’il devait vouloir voler vers sa mère, qui était partie vivre ailleurs. Puis il dit que non, au contraire, il devait désirer partir loin d’un foyer qui le limitait. Cette hésitation dans l’interprétation dit bien l’ambiguïté du voyage comme expérience existentielle. L’analyse l’autorise à envisager les deux options, à les articuler sans avoir à en rejeter une. Partir en voyage serait toujours une tentative de revenir à une origine idéale, de retrouver la mère perdue de l’enfance, et en même temps tentative de s’écarter d’une origine qui assigne. Le voyage, qu’il soit réel ou imagé, géographique ou dans le transfert à l’analyste, est le chemin d’un retour au cœur duquel se creuse un écart, un détour, un aller à la rencontre de l’altérité qui nous constitue.