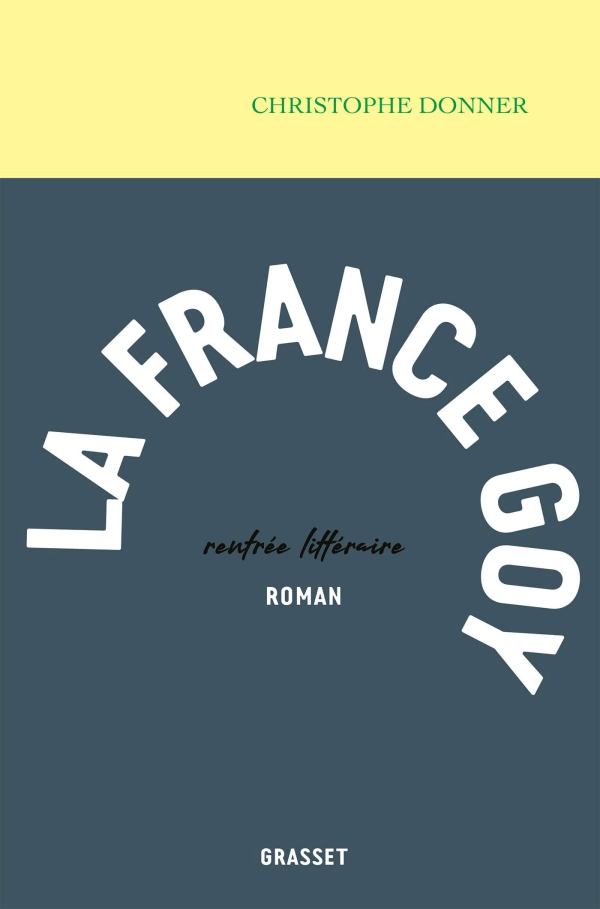ANTOINE STROBEL-DAHAN Votre premier livre, L’amour sans visage, parlait de votre histoire et de la Shoah, et non de littérature. C’est aussi lui qui a fait de vous une écrivaine. Ou l’étiez-vous déjà depuis longtemps, en gestation ?
HÉLÈNE WAYSBORD L’écriture de ce premier livre m’a demandé beaucoup d’années et a été un long cheminement vers quelque chose d’effacé parce que trop douloureux, la disparition de mes parents durant la guerre, vécue comme un abandon tragique. J’ai toujours voulu écrire, c’était semble-t-il la seule solution pour moi. La disparition brutale avait été accompagnée de la seule parole d’une femme venue me chercher à l’école à la place de mon père « Tes parents sont partis en voyage ». Phrase inconcevable. il me fallait trouver les mots pour surmonter, pour accepter enfin la réalité. Si aberrant que cela paraisse, il y avait en moi une petite fille restée à la sortie de l’école attendant la venue du père. C’est seulement quand j’ai eu terminé L’amour sans visage que j’ai repris la correspondance de mon père durant les quelques mois où il fut prisonnier à Beaune-la-Rolande, que j’ai relu ses lettres, que je les ai ressaisies à la machine et qu’elles ont été publiées.
ASD Votre premier livre consiste donc à articuler des mots pour soigner une blessure. Comment en êtes-vous venue à vous emparer de Proust pour ce deuxième ouvrage ?
HW Pour ce deuxième livre, le déclencheur sans aucun doute fut le confinement, un stimulus pour écrire cette histoire d’une longue familiarité avec Marcel Proust. Au moment du confinement en février-mars 2020, j’entends partout que l’enfermement est l’occasion de relire l’œuvre d’un homme enfermé dans une chambre de liège durant dix ans, À la Recherche du temps perdu. C’est une aberration car on ne se plonge pas ainsi dans La Recherche. La dimension de l’œuvre peut décourager même des lecteurs déjà avertis. Proust avait été présent à tous les moments importants de ma vie, me vient alors l’envie d’écrire quelque chose qui donne envie de rentrer doucement, sans heurts, par petites pincées, dans La Recherche. En donner le goût au lecteur pour aller plus avant.
ASD Vous vous présentez comme ancien professeur, mais on voit bien avec ce projet que le professeur ne vous a pas complètement quittée, vous faites là tout de même œuvre pédagogique.
HW Pour écrire, j’ai dû dépouiller le professeur. Lorsqu’on est professeur, on écrit un cours et on a les idées directrices avant de commencer. L’écriture est exactement l’inverse : un élan vous saisit, une volonté d’exprimer mais on ne sait pas exactement quoi. C’est toujours de l’impromptu qui surgit et ce qui marque mon écriture, est une façon d’entremêler des thèmes a priori très distincts mais de faire en sorte qu’il y ait une douceur, une fluidité, c’est un art de la composition au sens musical et même pictural. Un peu à la manière de Proust qui disait « je n’invente rien », je n’ai pas l’imagination de l’invention. Mais l’invention existe aussi dans la façon de combiner, de composer, d’organiser les strates qui s’interpénètrent.
C’est le livre qui vous révèle ce que vous cherchiez à dire. Lorsque j’écris, je cherche. Il y a quelque chose de paradoxal dans cet acte d’écriture qui coïncide avec une effervescence du langage qui vous conduit de façon jubilatoire.
DELPHINE AUFFRET Vous débutez votre livre comme un tableau, un tissage, les premiers fils sont cette image obsédante qui fait écho à d’autres images. Mais dans cette écriture, quelle est la strate originale ?
HW La strate originelle est le mystère, les couches successives qui se découvrent ne viennent à bout des énigmes. Une expression ou un titre peuvent lancer un livre, une fois les matériaux rassemblés. Par exemple pour mon premier livre, cette expression, « l’amour sans visage » et, à partir de là, le livre s’est composé. Pour La chambre de Léonie, j’ai senti très vite, qu’il me fallait découper une entrée modeste, ouvrir une fenêtre proustienne. De façon évidente, c’était la chambre.
La chambre de Combray, la chambre de Léonie, la chambre de Vinteuil, la chambre d’Albertine disparue, c’était tout un parcours disant l’épopée de la connaissance du réel. La chambre me parlait directement. À l’origine de ma vie d’enfant sauvée, il y a aussi une chambre, la chambre de satin rose dragée, qui est l’objet d’un chapitre. Chambre du romanesque où l’enfant, arrivée dans un lieu totalement étranger écoute une beauté brune évoquant ses déceptions amoureuses et ses illusions. Bien différente de la chambre de Léonie par la fenêtre de laquelle le narrateur enfant aperçoit la réalité assez triviale du village, ma première initiation fut romanesque.
DA C’est aussi la chambre de la sécurité ou de l’interrogation qui plane à côté des autres chambres proustiennes, et qui marque un parcours moins linéaire, plus algique, avec cette femme brune et belle qui vous protège d’un extérieur… Parce que ce chapitre ouvre le livre et tout se place sous son sceau.
HW J’ai tout à fait le sentiment que ce chapitre est énigmatique et je me demandais s’il fallait l’éclairer. Comme l’indique le titre, c’est une chambre comme on dirait à l’eau de rose, un romanesque de premier degré, un stéréotype. Il y a, au début de La Recherche du temps perdu, une première chambre, celle de Combray, celle où l’enfant est seul le soir sans le baiser maternel parce que Swan, l’invité de marque est là, et que la mère ne peut pas monter. La Recherche commence et repose sur un enfant en abandon et, évidemment, j’y étais très sensible car même si, aux yeux des gens raisonnables, il ne saurait y avoir de comparaison entre le narrateur enfant, Marcel, qui ne peut recevoir le baiser maternel, et l’enfant que j’étais orpheline par la disparition tragique des parents. Mais pour un enfant, il n’y a pas de différence, la peine est totale et absolue.
DA On retrouve cette pudeur dans votre écriture, parce qu’on sait cette histoire tragique qui fut la vôtre et, pourtant, votre écriture ne porte pas de pathos et frôle une certaine écriture blanche de l’événement central Shoah qui n’apparaît qu’en filigrane, presque dans un souffle, dans un silence. On sent que votre quête trouve un objet dans La Recherche, qu’il y a quelque chose qui vibre au-delà.
HW Dans la mesure où je me suis beaucoup occupée du problème de la mémoire auprès de l’Éducation nationale, je sais que s’exprimant sur la Shoah, il faut le faire un ton au-dessous, ne pas chercher à être emphatique. Les grands adjectifs et les qualificatifs ne servent de rien, on est toujours inférieurs à cette mémoire. Il faut plutôt la parole blanche qui laisse résonner simplement le mot Shoah, le mot extinction, les faits, les chiffres. Cette préoccupation majeure a sans doute été une école de mon écriture.
DA Lorsque vous, enfant, arrivez dans cette petite ville normande, vous êtes baptisée puis vous recevez une éducation catholique qui va au-delà d’une imprégnation intellectuelle. Qu’est-ce qui préside à ces choix chez ceux qui vous accueillent ? Une volonté de conversion ? De protection ?
HW Je l’ignore parce que jamais nous n’avons eu l’occasion avec la famille qui m’a accueillie et qui m’a ensuite élevée merveilleusement, d’aborder toute cette douleur sur laquelle nul ne voulait revenir. Ce n’était sûrement pas une volonté de conversion, l’homme était un laïc et ne fréquentait jamais l’église, la femme allait à la messe tous les dimanches sans bigoterie aucune. Il y avait probablement à la fois une volonté de protection et de m’intégrer de manière conforme au village pour que je sois comme tout le monde. Lorsque j’ai fait ma communion, je n’y ai pas vu une bizarrerie parce que c’était superficiel. Comme dans ma famille, on ne pratiquait pas, je n’ai aucun souvenir de rituel. J’adoptais le catholicisme comme beaucoup d’autres choses dans mon comportement à l’époque, en surface. J’étais ailleurs, je n’avais pas les deux pieds dans la même histoire.
DA Dans le livre, dans ce parcours d’une chambre à l’autre, on a l’impression que chaque chambre est un essai dans votre quête, que vous ne trouvez pas votre chambre idéale. D’ailleurs y en a-t-il une ?
HW Non, il n’y en a pas mais la chambre de satin rose dragée est tout de même essentielle parce que, étant la chambre du romanesque, c’est celle des récits où l’on s’évade en suivant de belles histoires, c’est par l’oralité, la première initiation à la littérature. Cette chambre est matricielle. Après avoir écrit ce livre, découvrant ce qui s’était écrit par ma main, je me suis aperçue qu’il y a deux initiatrices dans ce texte : la beauté brune Marie, qui porte le romanesque et sa rêverie passive, et la première institutrice, Mlle Tardivelle, celle qui, le matin, vous lit un texte et vous demande de répéter, initiant ainsi le langage structurant du travail de mémoire.
DA À la fin de votre livre on découvre ce passage si représentatif du texte :
« Au cours de ces semaines, lisant avec continuité, j’avais avancé dans la forêt obscure du Temps avec tout son peuple en transit. Des êtres de fuite ou en fuite qui échappaient à toute définition. Je ne m’y sentais pas dépaysée mais y trouvais au contraire une sorte de familiarité. Des silhouettes échelonnées dans la profondeur du temps, chacune suivie d’ombres portées, comme des empreintes dans le passé d’une forme d’existence déjà acquise. »
J’ai eu vraiment le sentiment que vous parlez d’un autre peuple, d’autres ombres. Il y a là une ambiguïté qui m’évoque des cohortes de prisonniers dans les forêts polonaises mais, en une toute petite phrase, vous me ramenez en Normandie.
HW Il est vrai que cette empreinte initiale marque toute la vision que l’on peut avoir. En écrivant ce livre, j’ai découvert un Proust fantomatique qui nous présente des êtres en perpétuelle métamorphose, jamais semblables à eux-mêmes. Cela correspondait à mon existence et à la vision que je pouvais avoir du monde qui avait été le mien.
Propos recueillis pour Tenou’a par
Delphine Auffret et Antoine Strobel-Dahan